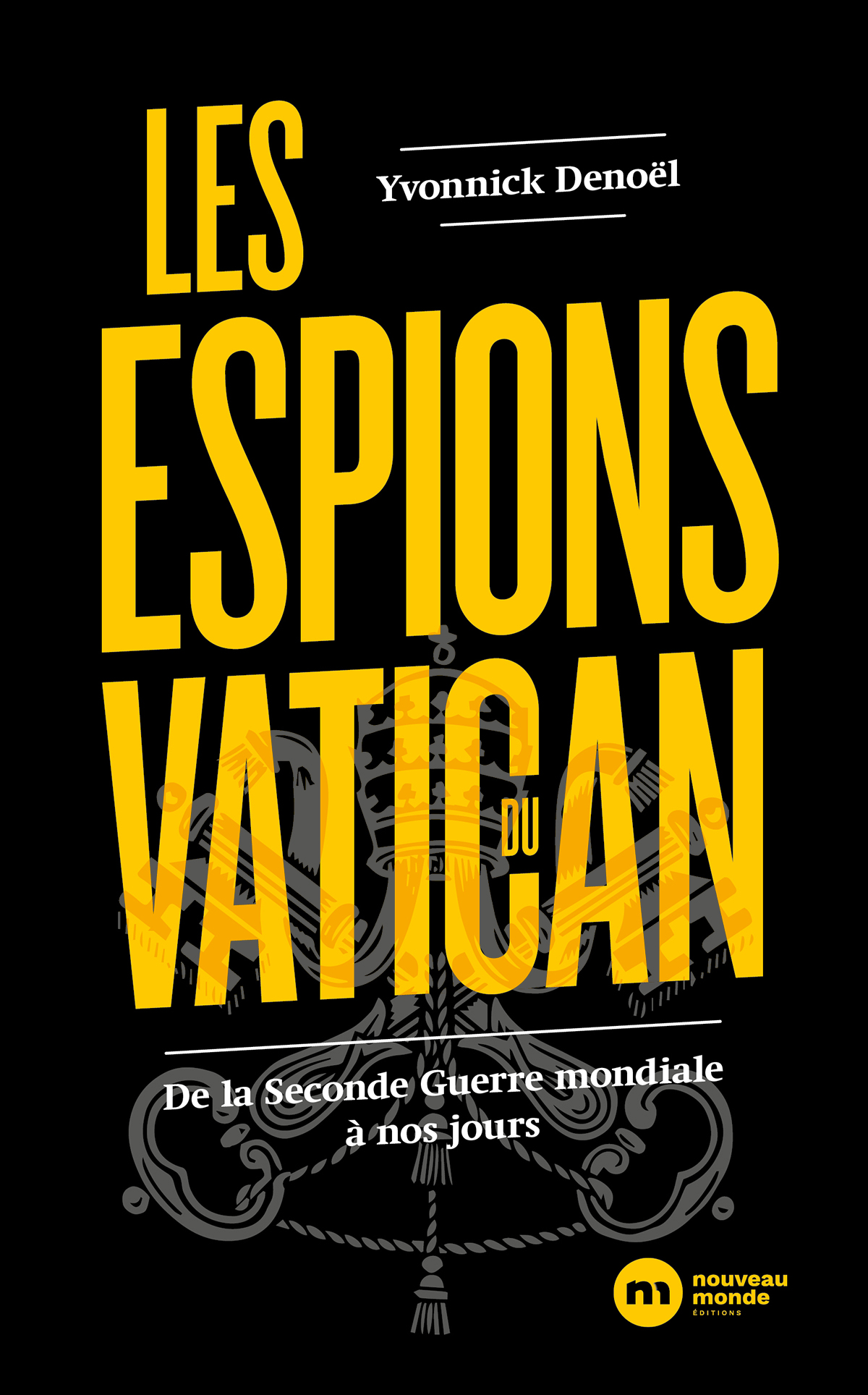Marianne : Le Vatican espionne et se fait beaucoup espionner. Officiellement pourtant, le plus petit État du monde n’a pas de services de renseignements. Qui sont donc ses espions ?
Yvonnick Denoël : C’est en partie vrai car le Vatican n’a pas de service de renseignement bien structuré avec un grand patron et des bureaux. Mais il a des réseaux évolutifs et mobiles qui varient selon chaque pape et qui dépendent de lui. Le Vatican a recours à des missions qui relèvent du renseignement et des opérations spéciales. Ces espions sont en général des prêtres, des prélats, des assistants des sous-secrétaires d’État, les nonciatures apostoliques [ambassade du Vatican à l’étranger] qui font du renseignement diplomatique, des congrégations. Le pape gère aussi des dossiers, des missions, parfois par l’entremise de son secrétaire personnel.
La forme et l’intensité des actions d’espionnage par le Vatican ont évolué au fil des siècles. Beaucoup d’actions ont été menées à l’époque moderne [seconde moitié du XVe siècle], puis les choses se sont un peu calmées. On a ensuite des résurgences au XIXe siècle et au début du XXe avec la création notamment d’une organisation interne qui était une véritable police politique, la Sapinière ou « Sodalitium Pianum » en latin. Mais cette police n’est pas permanente.
En revanche, il y a toujours eu un service de contre-espionnage au XXe siècle, quels que soient les papes. En général, ce sont des personnes très discrètes, qui n’apparaissent pas dans le haut de la hiérarchie et qui sont chargées de missions très discrètes. Ils ne sont jamais fichés par les services adverses et peuvent circuler en toute tranquillité. C’était le cas par exemple du père Graham, un jésuite qui n’avait aucune position dans la hiérarchie du Vatican mais qui a chassé les « taupes » qui s’étaient installées dans le Saint-Siège pendant des décennies.
Après son élection, Jean-Paul II a monté son propre réseau de renseignement. Comment fonctionnait cette cellule ?
Jean-Paul II a sans doute été le pape le plus versé dans le renseignement. Il a eu une vraie formation de chef de réseau car il a été éduqué sans le vouloir par les services polonais puisqu’il a dû apprendre la clandestinité en franchissant les marches de l’Église polonaise. Dès son élection, Jean-Paul II va s’appuyer sur des gens avec qui il a déjà travaillé dans la clandestinité et constituer un réseau de renseignement parallèle secret. Au Vatican, personne ne sait ce qu’ils font. Le soir, Jean-Paul II dîne avec ses émissaires et le cardinal Agostino Casaroli, le secrétaire d’État à l’époque, est complètement en dehors de la boucle. Il ne sait rien du dossier polonais.
Tout est géré par Karol Wojtyla et son secrétaire particulier, le cardinal Stanislaw Dziwisz, qui joue les trésoriers en donnant des liasses de billets aux agents du pape pour leurs voyages en Pologne afin de soutenir le syndicat Solidarité, « Solidarnosc » en polonais. Jean-Paul II est le grand patron qui contrôle tout. Il reçoit par exemple le chef de la CIA qui rencontre, normalement, un cardinal ou le secrétaire d’État.
Sous le règne de Karol Wojtyla, la relation avec les services américains est inversée. En général, la CIA donne peu et reçoit beaucoup. Or là, c’est le contraire ! Le patron des services secrets américains arrive dans le bureau de Karol Wojtyla avec une pile de dossiers contenant par exemple des photographies aériennes lorsqu’on craint une invasion de la Pologne par les divisions soviétiques. Mais il repart à chaque fois les mains quasiment vides.
Quel bilan tirez-vous des services sous Benoit XVI ?
Tout le monde pensait que Joseph Ratzinger était l’homme du BND [Bundesnachrichtendienst, Service fédéral de renseignement]. Cela résulte d’une incompréhension car il était le cardinal chargé de faire le lien avec les services secrets allemands de la même manière que d’autres cardinaux sont chargés des relations avec les renseignements de leur pays d’origine. Ce qui ne veut pas dire qu’ils sont tous des agents.
Benoit XVI est un rigoriste. Il sait que le pontificat de Jean-Paul II a suscité des problèmes parce que la priorité accordée à la lutte anticommuniste a laissé sous le tapis des questions importantes comme les affaires de pédophilie. Il esquisse d’abord un nettoyage et commet après des erreurs humaines terribles. Le management ne l’intéresse pas. Il met en place des gens qui se haïssent et c’est le début d’une série de coups tordus avec des factions qui font sortir des dossiers.
Et le pape François ?
Je ne perçois pas chez lui une volonté de déployer un nouveau type de renseignement adapté aux enjeux actuels mais plutôt un besoin de surveillance beaucoup étroite de l’épiscopat pour savoir où sont les cadavres dans les placards et qui est susceptible de poser des problèmes. C’est visiblement devenu une obsession pour le pape actuel et il a mis en place une organisation bien huilée qui représente toutefois des dangers car les cardinaux se sentent espionnés jusque dans leur vie privée. Il veut maîtriser la Curie qui était en roue libre depuis la fin du pontificat de Jean-Paul II. Mais il se pourrait que des réseaux aient été montés et nous ne le savons pas.
Vous évoquez dans ce livre le génocide rwandais. Vous parlez de « l’honneur saccagé » de l’Église. Vous accusez l’Église d’avoir participé à la création d’un nationalisme hutu et vous n’êtes pas tendre avec le pape François qui a imploré le pardon de Dieu en accueillant le président Paul Kagamé au Vatican en 2017.
Le pape François a essayé de reconnaître les erreurs de l’Église sans pour autant braquer complètement ses troupes. C’est une subtilité toute jésuite. À aucun moment je ne dis que le génocide du Rwanda repose principalement sur les épaules de l’Église. Mais on a eu quelque chose d’absolument atroce, la participation d’un certain nombre de religieux et de religieuses impliqués dans ce génocide commis par les Hutus contre les Tutsis. Quelques années plus tard, des gens comme le réseau des pères blancs belges essayaient encore de défendre et de protéger les complices du génocide. C’est une tache que l’on ne peut pas effacer et pour l’essentiel, le pape François l’a reconnue.
Ce qui est étonnant, c’est que nous autres Européens, nous ne nous rendons pas compte que cet aspect du génocide rwandais a été très peu médiatisé alors qu’au Rwanda, l’influence de l’Église a reculé parce que la population a été choquée par ce qu’elle a vu. Le Vatican s’est laissé intoxiquer par les rapports de ses responsables sur place. C’est une défaite du renseignement du Vatican et cela illustre le fait que cet État fait trop confiance à ce qu’il reçoit d’un pays. On l’a vu aussi en Amérique du Sud où des nonces ont tenu des propos lénifiants sur des chefs d’État qui étaient soi-disant sur le chemin de la démocratie.